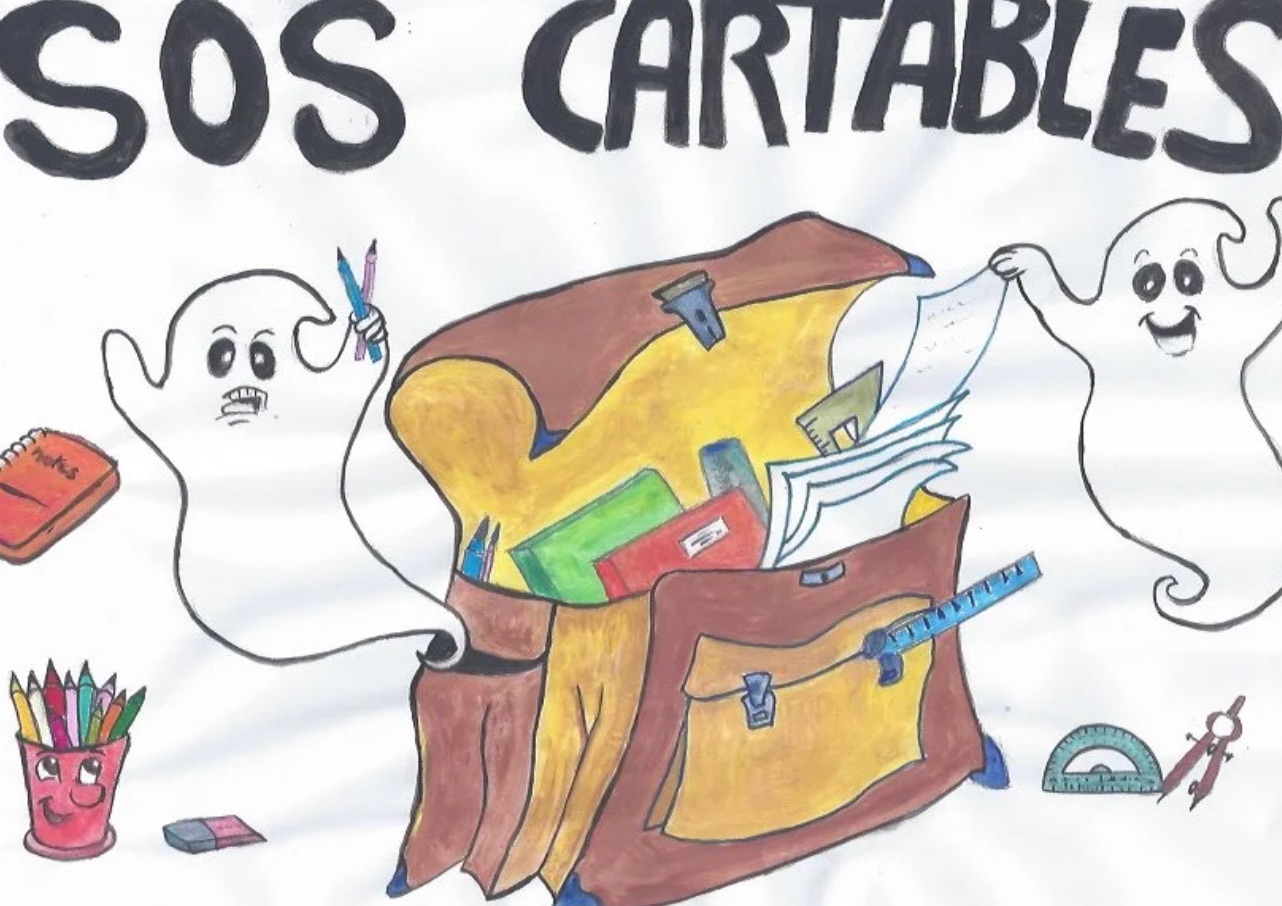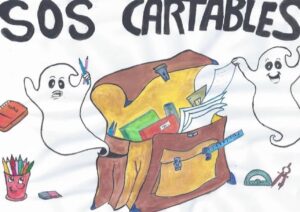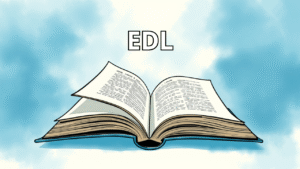La géographie occupe une place essentielle dans le parcours scolaire des élèves du primaire. Elle ne se limite pas à l’étude des cartes : elle constitue une clé de compréhension du monde et des sociétés humaines. Pourtant, lorsqu’on interroge les enseignants de CM2 sur le programme officiel actuel, les avis divergent fortement. Pour certains, il est en décalage avec les besoins réels des élèves ; pour d’autres, il représente une avancée pédagogique. Cet article propose un tour d’horizon des différents points de vue, en analysant les forces et les limites du programme de géographie de CM2.
1. Ce que prévoit le programme officiel
Le programme de géographie de CM2 s’articule autour de grandes thématiques contemporaines :
- Se déplacer
- Communiquer grâce à Internet
- Habiter une métropole
- La France et le monde
L’approche est donc centrée sur la notion d’habiter : comment les individus vivent, se déplacent, échangent, transforment et s’adaptent à leur environnement. L’objectif affiché est de dépasser une géographie purement descriptive (les fleuves, les montagnes, les capitales) pour amener les élèves à réfléchir à leur propre rapport à l’espace et à celui des autres.
Cette philosophie est en cohérence avec les évolutions des sciences humaines et avec l’enseignement secondaire, où l’on insiste de plus en plus sur les dynamiques territoriales, la mondialisation et les enjeux environnementaux.
2. Les critiques récurrentes : un programme déconnecté des fondamentaux
Une large partie des enseignants exprime des réserves, parfois très fortes, sur la pertinence de ce programme. Plusieurs arguments reviennent régulièrement.
a) Un manque de bases solides
De nombreux professeurs estiment que les élèves arrivent en CM2 sans maîtriser des savoirs géographiques élémentaires :
- savoir placer la capitale de la France,
- identifier les principaux fleuves et massifs,
- connaître les grands repères européens et mondiaux.
Or, le programme insiste sur des notions complexes (réseaux, métropole, mondialisation) au détriment de ces acquis jugés indispensables. Comme l’explique un enseignant : « Il me semble nécessaire de connaître déjà notre capitale et de la placer. Les élèves qui arrivent de CM1 n’y arrivent déjà pas. »
b) Des notions trop abstraites pour des enfants de 10–11 ans
Si la géographie doit aider à comprendre le monde, encore faut-il que les concepts soient accessibles. La question d’Internet ou des mobilités mondiales paraît à certains trop éloignée des préoccupations d’élèves encore jeunes. D’où une impression de « programme conçu pour des adultes » sans réelle adaptation pédagogique au niveau CM2.
c) Une instabilité des instructions
Les enseignants pointent aussi une autre difficulté : les programmes changent fréquemment. Ce manque de stabilité entraîne une forme de lassitude : « Ça va encore changer l’année prochaine, donc inutile de trop se focaliser » résume une maîtresse.
d) Une déconnexion avec les attentes des familles
Les parents associent souvent la géographie à la connaissance des cartes, des continents, des capitales. Lorsqu’ils découvrent que le programme met davantage l’accent sur « habiter une métropole » ou « communiquer grâce à Internet », ils peuvent juger que l’école ne remplit pas sa mission de transmission des repères fondamentaux.
3. Les arguments en faveur du programme
À l’inverse, plusieurs enseignants défendent l’orientation actuelle du programme et soulignent ses atouts.
a) La géographie, ce n’est pas seulement les cartes
Certains rappellent que la géographie scolaire a longtemps été réduite à une mémorisation de listes : fleuves, montagnes, préfectures. Or, cette approche est jugée réductrice et peu formatrice. Le nouveau programme propose une vision plus vivante, où les élèves explorent leur rapport à l’espace et aux territoires.
b) Une ouverture sur les enjeux contemporains
Le fait de parler de mobilités, de réseaux numériques ou de mondialisation est perçu comme une manière de relier la discipline au monde actuel. Les élèves comprennent que la géographie n’est pas figée, mais qu’elle permet d’analyser des phénomènes qui structurent leur quotidien.
c) Une continuité avec le collège
Les enseignants de collège reprennent et approfondissent ces thèmes. Le programme de CM2 constitue donc une introduction progressive. Même si certains élèves n’ont pas tous les repères cartographiques, ils les construisent au fil du cycle 3 (CM1, CM2, 6e).
d) Une place laissée à la pédagogie active
La notion d’« habiter » ouvre la porte à des projets variés : étude de la ville où vivent les élèves, analyse des moyens de transport qu’ils utilisent, enquête sur leurs usages numériques. Autant de situations concrètes qui favorisent l’implication et le sens.
4. Des pratiques très hétérogènes dans les classes
Face à ce programme jugé à la fois ambitieux et insuffisant, les enseignants adoptent des stratégies diverses.
- Certains ne le suivent pas du tout : ils privilégient un retour aux bases en consacrant l’année aux cartes et aux repères physiques.
- D’autres font un compromis : ils abordent les thèmes officiels mais en y ajoutant des séances classiques de géographie physique.
- Quelques-uns l’assument pleinement : ils se concentrent sur la notion d’habiter et considèrent que les bases peuvent être acquises ailleurs (dans les autres années ou au collège).
Cette diversité reflète une tension entre les prescriptions officielles et les convictions pédagogiques des enseignants. Elle engendre aussi des inégalités entre élèves, selon l’école et l’enseignant qu’ils rencontrent.
5. Quels enjeux derrière ce débat ?
Derrière la discussion technique sur le programme, plusieurs enjeux de fond apparaissent.
a) La mission de la géographie à l’école primaire
Faut-il d’abord transmettre des repères concrets (capitale, fleuves, reliefs) ou développer des compétences de réflexion (comprendre comment les humains habitent et transforment l’espace) ? Le programme privilégie la seconde approche, mais beaucoup d’enseignants et de parents attendent la première.
b) L’égalité des élèves face aux savoirs
Un programme trop conceptuel risque de creuser les écarts. Les élèves issus de milieux favorisés, déjà exposés à Internet, aux voyages, aux cartes, comprendront mieux les notions d’« habiter » et de « mondialisation ». Ceux qui n’ont pas ces références de départ peuvent se retrouver perdus.
c) La place de la culture commune
La géographie est aussi un élément de culture partagée. Savoir placer Paris, le Rhône ou les Alpes fait partie de ces savoirs que l’on suppose connus de tous. Leur absence peut être vécue comme un déficit culturel.
6. Vers un équilibre entre bases et enjeux contemporains
À la lecture des arguments des uns et des autres, il semble que la question ne soit pas tant de choisir entre bases cartographiques et géographie vivante, mais de trouver un équilibre.
- Intégrer les fondamentaux : en CM2, il paraît indispensable de consolider les repères simples (capitale, grands fleuves, reliefs principaux).
- Donner du sens : les thèmes liés à l’habiter, aux mobilités et aux réseaux peuvent être abordés, mais en lien avec la vie quotidienne des élèves.
- Articuler avec le collège : le CM2 devrait assurer une transition, en introduisant des notions plus complexes tout en vérifiant les acquis de base.
- Clarifier les attentes : pour éviter les inégalités, une partie des programmes pourrait définir plus précisément les savoirs cartographiques attendus.
7. Conclusion : un programme de géographie en CM2 à repenser ?
Le programme de géographie en CM2 illustre bien la difficulté de concilier deux visions de l’enseignement :
- une vision classique, centrée sur la transmission de repères communs et stables,
- une vision moderne, tournée vers la compréhension du monde actuel et des dynamiques sociales.
Les enseignants, eux, oscillent entre ces deux pôles et adaptent selon leurs convictions et leur public d’élèves. Beaucoup estiment qu’une réforme prochaine est nécessaire pour réintroduire davantage de repères de base, sans pour autant renoncer à l’ouverture sur les enjeux contemporains.
En définitive, la pertinence du programme dépend moins de son texte officiel que de la capacité de l’école à combiner les savoirs fondamentaux et les compétences de réflexion. La géographie doit rester à la fois une discipline de repères et une discipline de sens : savoir où l’on est, et comprendre comment le monde fonctionne.